Ophélie Roque est professeure de français en banlieue parisienne et publie régulièrement dans notre Lettre. Elle vient de sortir un livre témoignage sur ce qu’elle vit au quotidien au sein de l’Education nationale. Poignant et inquiétant. Il est temps qu’une grande réforme soit mise en place pour sauver l’école avec ses élèves et ses enseignants. Extraits.
Sur l’absence des professeurs
Certes, nous sommes parfois absents ,mais pas forcément pour les raisons que l’on pourrait croire (ou que l’on aurait envie de croire). En effet, l’emploi du temps se fragmente et s’émiette tel un biscuit sec selon les périodes : cours annulés pour la tenue de conseils de classe, absences provoquées par le calendrier des formations, séances déplacées par la vie scolaire….Si le professeur manque quelques cours, c’est souvent moins sa faute qu’en raison des impératifs et contraintes du métier. Vous me direz que cela ne change rien pour les élèves. Soit ! Mais du moins voici rétablie la délicate balance de la vérité.
Sur l’état des bâtiments
Un rapport de la Cour des comptes indique qu’un tiers des bâtiments universitaires sont dans un état pitoyable ; à cela il faut ajouter une myriade d’écoles, de collèges et de lycées qui sont, eux aussi, à la frontière de l’indicible. Près de 70% des établissements scolaires présenteraient des signes de mauvais état, entre moisissures, défaut d’aération, amiante, passoire thermique et sous-équipements. La décrépitude est généralisée. Le ministère de l’Education nationale admet que 10% des établissements montrent une « vétusté » importante. En Ile-de-France, ce sont 30% des lycées ! Parfois la sécurité des élèves et des personnels y est même remise en question. Et ce n’est pas près de s’arranger si on ne fait rien.
Comment devient-on professeur de latin ?
Vous n’avez jamais fait de latin ? Qu’importe! Vous apprendrez en même temps que les élèves ! Et me voici à enseigner la langue latine aux collégiens. Il n’y a pas à dire, le rectorat a l’esprit d’initiative… et la confiance facile!
Pour le collège passe encore, mais lorsqu’on me nomme professeure de latin, au lycée, je proteste catégoriquement. Un membre du rectorat m’appelle, d’accord pour enlever l’enseignement du latin au lycée, mais encore faut-il qu’en échange j’accepte d’enseigner le grec ancien ! Le refus est formel. C’ est que nous finirions par nous fâcher ! Cet aparté tout personnel est néanmoins symptomatique de l’état assez, désastreux de l’enseignement des lettres classiques. Depuis les années 2000, le recrutement a diminué si drastiquement que, dix ans plus tard, n’y avait même plus assez de candidats pour les postes mis au concours. En une vingtaine d’années, les réformes successives ont fini par décourager les apprentis latinistes et hellénistes, qui ne sont plus que 15 % aujourd’hui à prendre l’option en cinquième, contre près de 23 % au début du siècle. Sur les 400 000 collégiens qui reçoivent cet enseignement, seuls 1 300 le conserveront au lycée et 400 le passeront au bac !! C’est la longue lignée d’un savoir classique hérité des fonds immémoriaux qui s’effondre. Rimbaud savait versifier en latin à seulement 15 ans, il est désormais certain que ce genre de prouesse ne sera guère plus renouvelé.
La mort des manuels scolaires
Les manuels ont, eux aussi, subi le même sort que l’agenda : ils ont été dématérialisés. Mais, contrairement au cahier de texte, il n’est même plus possible d’en avoir une version papier, les manuels ne sont plus accessibles que sur tablette ou ordinateur. Autant dire qu’ils sont devenus inexistants !
Véritable aberration, le passage au tout-numérique a tué avec lui la curiosité. Jadis (nous en sommes déjà là…), un élève qui s’ennuyait avait toujours la possibilité de s’égarer, corps et âme, dans l’effeuillage plus ou moins distrait des pages du manuel. Ce n’était pas qu’il soit bien plus passionné par l’écriture de Zola que par celle de Giono, mais, enfin, c’était une forme de liberté comme une autre : on avait la possibilité de ne pas suivre le cours tout en s’instruisant par ailleurs. Même sans le vouloir. Surtout sans le vouloir!
De cette consultation hâtive et facultative on ressortait, l’air de rien, avec un bout d’extrait en tếte. A tout le moins, on avait ricané devant l’infinie laideur des portraits de Jean-Paul Sartre. La moquerie est une ouverture comme une autre à la littérature. À titre personnel, c’est en feuilletant mon manuel de français que je suis tombée sur le pastel de Jean-Jacques Rousseau peint par Maurice-Quentin de La Tour qui m’a donné envie de lire un auteur par moi-même.




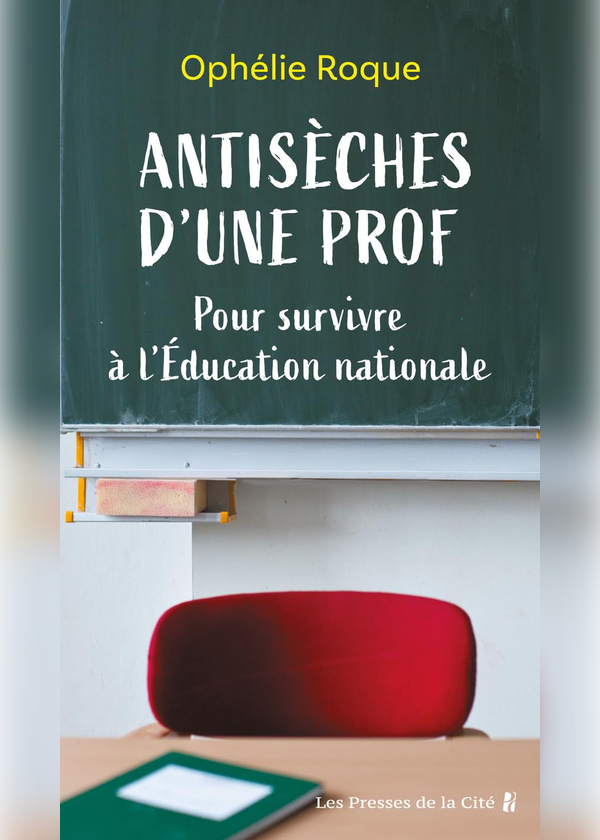

2 commentaires
Très beau métier … qu en v’avez vous fait ? Plus de candidats aux concours… des recrutements d incompétents qui seront titulaires sans concours sans les bons diplômes donc les connaissances au bout de 5 ans… école et envie d apprendre … sacrifiés !!
C’est tellement triste !