Dans son dernier livre tout récemment paru (La Vertu dangereuse, Paris, Éditions de l’Observatoire), la philosophe Julia de Funès radiographie et discute les grandes tendances actuelles qui traversent de part en part le monde de l’entreprise : principe de précaution, lutte contre les discriminations, écriture inclusive, transition écologique, bien-être au travail, parité, parmi bien d’autres thèmes. La thèse centrale de l’essai est que – comme l’indique clairement le titre – derrière l’apparente ouverture croissante des organisations à la « bienveillance », à la « diversité » et à l’ « inclusion » se cache en réalité une injonction d’autant plus pernicieuse et tyrannique qu’elle se drape dans sa prétendue vertu. On songe ainsi à certains précédents, tel Philippe Muray, cet infatigable pourfendeur de l’ « Empire du Bien » et de la « bonté despotique », que Julia de Funès cite. On pense aussi au fameux aphorisme de Pascal, selon lequel « qui veut faire l’ange fait la bête ». Une vérité d’autant plus actuelle que les entreprises ont été de plus en plus largement gagnées au fil des années, dans leur communication, voire dans leur fonctionnement même, par le politiquement correct puis par le wokisme. Désormais pétris de bons sentiments, les services ressources humaines rivalisent d’imagination pour favoriser le « bien-être au travail », qui semble être devenu la nouvelle vertu cardinale des organisations.
Ce qui est dit ici du monde de l’entreprise peut d’ailleurs être étendu à la société tout entière. La bien-pensance est devenue la nouvelle idéologie des sociétés occidentales, dont les contempteurs n’ont de cesse de marteler l’idée qu’elles et elles seules seraient à l’origine de tous les maux de la planète, et qu’elles devraient donc ainsi faire pénitence. « L’idéologie, disait Revel, c’est ce qui pense à votre place ». C’est exactement le même phénomène qui est à l’œuvre avec la bien-pensance, laquelle, dit Julia de Funès dans un entretien au Figaro Magazine (18 octobre 2024), « substitue à la réflexion l’expression d’une opinion majoritaire ». « La valeur d’une idée, d’un raisonnement ou d’un argument, ajoute-t-elle, n’est plus liée à sa pertinence ou à sa subtilité mais à sa conformité au credo moral du moment, à son accréditation collective. De sorte que, sur certains sujets, seule la pensée unique dans sa sottise satisfaite à voix au chapitre ».
Aussi, loin de nier l’importance des différents problèmes qu’elle soulève dans son livre, la philosophe nous invite plutôt à sortir de l’ornière idéologique afin de recouvrer liberté de jugement et indépendance d’esprit, trop souvent étouffées aujourd’hui par le carcan de la dictature morale du « Bien ». Prenons par exemple l’écologie. Julia de Funès fait clairement la distinction entre écologie (souhaitable, et même sans doute nécessaire) et écologisme (dangereux car tenant du mode de pensée et de fonctionnement propre à l’idéologie). « Jamais l’écologisme ne convaincra quiconque d’être plus écologique, écrit-elle. (…) Jamais l’écologisme ne servira la cause écologique » (p. 105). « Déjouer l’écologisme, ajoute-t-elle, est donc la meilleure chose que l’écologie puisse faire pour devenir plus efficiente. Cela supposerait de ne pas faire de l’écologie une idéologie d’appartenance, de ne pas faire de l’écologie une justification identitaire » (p. 107-108). Il en va de même du radicalisme woke, « nouveau dispositif moralisateur (qui) se propage comme une pandémie » (p. 33). Il doit être d’autant plus énergiquement dénoncé et combattu par des moyens intellectuels qu’il avance sous le masque du « Bien » et du « Juste ». « C’est parce que l’on observe, écrit Julia de Funès, une évolution grandissante de ces métastases idéologiques qui sentent bon la vertu, qu’il faut en déjouer immédiatement les rouages avant leur généralisation aveugle et leur adoption définitive » (ibid.).
Par où l’on voit que cet essai n’est pas celui d’une intellectuelle « contemplative », mais bien tournée vers l’action : c’est parce que l’écologisme, le wokisme, le décroissantisme, l’ultra-féminisme – « je pense à certaines néo-féministes, écrit par ailleurs l’auteur (p. 32), qui semblent guidées dans leur exaspération moins par l’amour des femmes que par la haine des hommes » – n’ont pas encore complètement détruit nos sociétés, mais pourraient bien le faire un jour si nous n’y prenons pas garde, qu’il faut agir en réfutant ces idéologies aussi fausses que délétères.




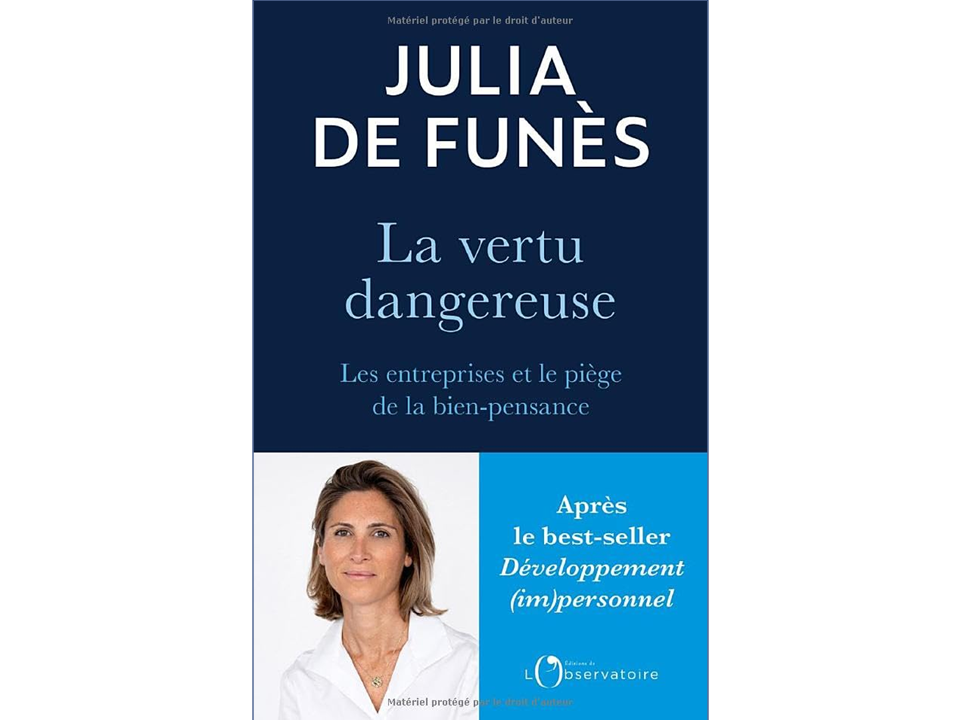

1 commenter
Un papier excellent sur un livre qui mérite sûrement d’être lu : merci !