L’Occident a connu un développement exceptionnel, très supérieur à celui des autres civilisations, du moins avant que celles-ci travaillent à le rattraper en s’alignant plus ou moins sur le modèle occidental. Le succès de notre civilisation est dû sans doute à divers facteurs. Le climat, l’environnement, des mutations génétiques peut-être… ont pu jouer un rôle favorable. Mais il est très probable que la reconnaissance du libre arbitre, et donc de la liberté, puis le respect de la singularité personnelle et de la propriété ont été des éléments déterminants de la construction de l’Occident en tant que civilisation. Jusque-là le monde était soumis au destin et à des dieux exigeants et souvent arbitraires : « Il faut porter d’un cœur léger le sort qui vous est fait et comprendre qu’on ne lutte pas contre la force du destin » énonce Eschyle (535/457) dans son Prométhée enchaîné (vers 103-105). Mais une heureuse conjonction a permis de faire émerger la liberté et la singularité humaine au travers de la religion juive, de la philosophie grecque et du droit romain tandis que d’autres civilisations restaient indifférentes à la liberté, dans les sagesses asiatiques notamment, ou hostile au libre arbitre, dans l’Islam en particulier, ce qui a été un handicap à leur développement.
Mais alors la question se pose de savoir pourquoi sur le plan économique, social et politique, il aura fallu attendre l’ère moderne, notamment des XVIIème et XVIIIème siècles pour amorcer l’essor incroyable, manifesté plus encore dans la révolution industrielle du XIXème siècle, de notre civilisation. Cet essor est dû à l’émergence de la liberté individuelle en trois grandes périodes où se sont toujours conjuguées des évolutions propres aux institutions, aux comportements individuels et à la pensée.
Le momentum du libre arbitre
Entre le VIIème et le Vème siècle avant JC advient le momentum du libre arbitre. Le monde méditerranéen découvre la liberté.
Le Judaïsme
D’abord, le judaïsme, probablement le premier monothéisme, avait commencé de penser l’homme comme être libre. Il est né peut-être à la fin du 2ème millénaire avant JC en pays d’Égypte ou Moïse aurait reçu l’inspiration du Pentateuque (la Torah des juifs). Mais il fut rédigé à partir sans doute du VIIème siècle pour trouver sa version aboutie au Vème. Dès la Genèse, Dieu laisse l’homme libre de manger le fruit de l’Arbre de la connaissance, mais, lui dit-il, « le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse, 2, 15-17). Le message de liberté est réitéré à moult reprises : « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… » (Josué, 24,15). Et l’histoire rappelle l’incroyable ténacité, la résilience de ce peuple pour défendre sa liberté de foi.
Rome
Rome a trouvé une certaine liberté par le droit. La République est instituée en 509 avant JC avant que, 60 ans plus tard, soient édictées les lois des douze tables (autour de 450) qui reconnaissent des droits aux individus, une sorte de prémisses d’un état de droit. La propriété était reconnue et protégée. La justice était garantie à tous avec la possibilité de faire appel. Les crimes et délits étaient prévus et les peines fixées. Tous les citoyens avaient les mêmes droits. Les justiciables avaient la possibilité de faire prévaloir leur accord sur la décision des juges.
Rome respectait les libertés privées tant qu’elles ne nuisaient pas à celle de la Cité. La jurisprudence des jurisconsultes puis des préteurs y établirent un droit évolutif et attentif aux situations individuelles. Les citoyens, tous égaux en droit, étaient théoriquement libres de grimper dans la hiérarchie des honneurs qui était celle de l’État. « En ce qui concerne le droit, la loi, la liberté, la chose publique, écrivait Caton l’ancien, il convient que nous en jouissions tous en commun également ; mais pour ce qui est de la gloire et des honneurs, à chacun de se les procurer comme il peut ». La famille y était sanctuarisée sous l’autorité du Pater familias qui avait tous les droits chez lui, qui y révérait ses propres dieux, ses Pénates, et dont la propriété était respectée. Ensuite le droit évolua en même temps que l’empire se muait en monarchie bureaucratique et souvent despotique.
La Grèce
Les XII tables d’ivoire romaines s’inspiraient sans doute en partie des lois de Solon (vers 640/558 av. JC) qui esquissa une des premières constitutions et qui se prévalait d’avoir « rédigé » un droit, la dikè, égal pour tous. Puis vint le siècle d’or de Périclès. Celui-ci a, le premier peut-être, considéré que « l’objet des constitutions n’est pas de confirmer la prééminence de tout intérêt que ce soit, mais d’y faire obstacle ; qu’il est de veiller avec un soin égal à l’indépendance du travail et à la sécurité de la propriété ; de protéger les riches de l’envie et les pauvres de l’oppression ». Dans son oraison aux mort au champ d’honneur (en 431 ?), Périclès, par les mots que Thucydide (460/400-395) lui prête, résume les principes de liberté qui animèrent Athènes et permirent sa grandeur. Certes, il s’agit d’une liberté ordonnée à la Cité. Mais c’est au nom de cette liberté que les Grecs combattaient. Les citoyens se sentaient libres parce qu’ils décidaient de leurs lois, au risque d’en abuser parfois. Leur supériorité était de n’être esclaves de personne, de se battre pour eux-mêmes, ce qui leur permit de vaincre les Perses, beaucoup plus nombreux et puissants, à Marathon en 490, puis sur la mer à Salamine en 480. « Leur victoire sur mer, dit au siècle suivant l’orateur Lysias après Salamine, montra qu’une poignée d’hommes affrontant la lutte pour la liberté vaut mieux que des foules d’esclaves combattant sous un roi pour leur servitude ».
Cette liberté revendiquée fut ensuite mise en scène par Sophocle avant que d’être conceptualisée par Aristote. Chez Sophocle (495/406), dans sa tragédie Électre, Oreste et sa sœur Électre prennent d’eux-mêmes la décision de venger leur père Agamemnon en tuant son assassin Égisthe devenu l’amant de leur mère. « Ne comprends-tu pas, chante le chœur, comment tu ne dois qu’à toi-même les misères où, sans respect de toi, tu t’es jetée ? ». La fille d’Œdipe, Antigone se lève, elle, contre le destin pour enterrer son frère Polynice. Au siècle suivant, la pensée grecque fait émerger le libre arbitre. « L’homme est principe de ses actions » observe Aristote. Il délibère sur les fins qu’il veut atteindre et il choisit les moyens qu’il croit appropriés à ses fins car « là où il dépend de nous d’agir, il dépend aussi de nous de ne pas agir, et là où il dépend de nous de dire non, il dépend aussi de nous de dire oui ». Aristote influença ensuite une large partie de la philosophie gréco-romaine, en particulier celle de Cicéron qui dans son De fato a reconnu le libre arbitre humain.
Une liberté limitée
Et néanmoins, cette liberté n’était encore, disait Lord Acton, que celle de ceux qui « concentraient tant de prérogatives dans le giron de l’État qu’il ne restait plus d’espace d’où quiconque eût pu contester ses décisions ou fixer des limites à son action…. Les obligations les plus sacrées s’effaçaient devant les intérêts supérieurs de l’État. Les passagers n’existaient que pour le bien du bateau » .




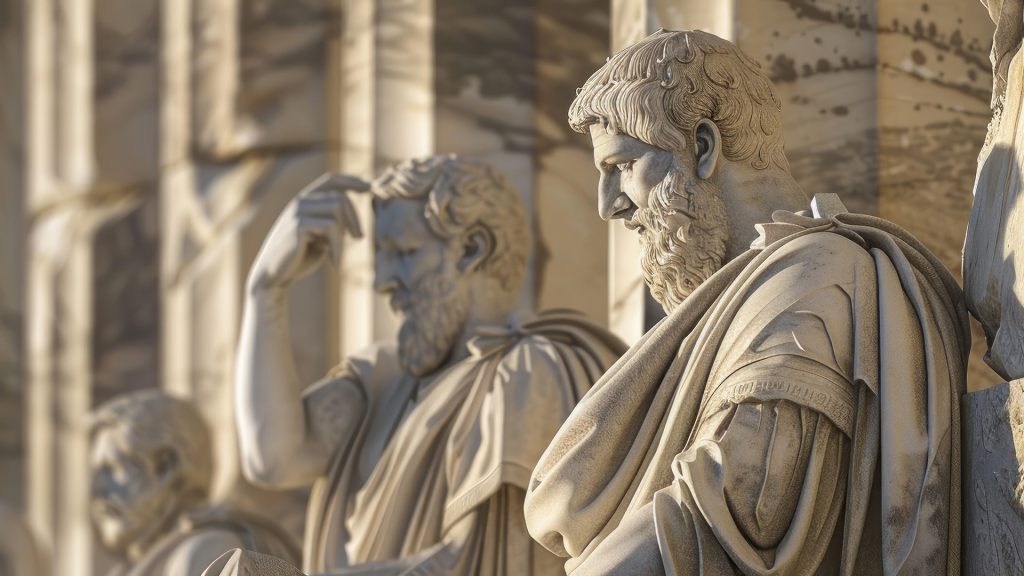

11 commentaires
Très intéressant, à inclure dans les programmes scolaires!
Bonjour
Ne pas oublier la Mésopotamie.
GUDEA, URUKAGINA ET L’ORIGINE DU CONCEPT DE LIBERTÉ EN MÉSOPOTAMIE – Martin Masse – directeur du Québécois Libre.
— “…
Une tablette d’argile datant de 2300 av. J.-C. raconte ainsi les fascinantes réformes libérales d’Urukagina, un prédécesseur de Gudea à Lagash, qui a dirigé cette principauté un siècle et demi avant lui. Le sumérologue Noah Kramer en fait cette description dans son livre From the Tablets of Sumer: Twenty-Five Firsts in Man’s Recorded History (The Falcon’s Wing Press, 1956):
“Urukagina, the leader of the Sumerian city-state of Girsu/Lagash, led a popular movement that resulted in the reform of the oppressive legal and governmental structure of Sumeria. The oppressive conditions in the city before the reforms is described in the new code preserved in cuneiform on tablets of the period: “From the borders of Ningirsu to the sea, there was the tax collector.” During his reign (ca. 2350 B.C.) Urukagina implemented a sweeping set of laws that guaranteed the rights of property owners, reformed the civil administration, and instituted moral and social reforms. Urukagina banned both civil and ecclesiastical authorities from seizing land and goods for payment, eliminated most of the state tax collectors, and ended state involvement in matters such as divorce proceedings and perfume making. He even returned land and other property his predecessors had seized from the temple. He saw that reforms were enacted to eliminate the abuse of the judicial process to extract money from citizens and took great pains to ensure the public nature of legal proceedings.”
C’est aussi sur cette tablette qu’on a trouvé les fameux signes cunéiformes exprimant le mot amagi (ou amargi), c’est-à-dire « liberté », qui constitueraient la plus vieille représentation écrite de ce concept dans l’histoire de l’humanité. Kramer en explique le contexte dans ce très intéressant paragraphe d’un autre de ses livres, The Sumerians. Their History, Culture and Character (University of Chicago Press, 1963, p. 79):
“As can be gathered from what has already been said about social and economic organization, written law played a large role in the Sumerian city. Beginning about 2700 B.C., we find actual deeds of sales, including sales of fields, houses, and slaves. From about 2350 B.C., during the reign of Urukagina of Lagash, we have one of the most precious and revealing documents in the history of man and his perennial and unrelenting struggle for freedom from tyranny and oppression. This document records a sweeping reform of a whole series of prevalent abuses, most of which could be traced to a ubiquitous and obnoxious bureaucracy consisting of the ruler and his palace coterie; at the same time it provides a grim and ominous picture of man’s cruelty toward man on all levels-social, economic, political, and psychological. Reading between its lines, we also get a glimpse of a bitter struggle for power between the temple and the palace – the “church” and the “state” – with the citizens of Lagash taking the side of the temple. Finally, it is in this document that we find the word “freedom” used for the first time in man’s recorded history; the word is amargi, which, as has recently been pointed out by Adam Falkenstein, means literally “return to the mother.” However, we still do not know why this figure of speech came to be used for “freedom.”
…” –
A++ et bonnes fêtes de fin d’années à tous.
Nicolas Carras
merci de cet éclairage de l’apparition de la liberté, très intéressant de constater combien les monothéismes ont approprié la liberté pour nous imposer une « liberte » révélée ! alors que la sagesse humaine libre suffit à inspirer de bon gouvernement
merci mr delsol
merci mr carras
oui la liberté de penser
la liberté de créer
la liberté de relier les opportunités,idées,resources,volontés grâce au chaos (relatif) de l’europe de l’éveil hors des dogmes, nous a permis de comprendre le monde et de nous l’approprier intellectuellement puis matériellement. mais les religions ont plus imposé leurs vérités révélées et bridé cet élan vital. Abraham est né chez les zoroastriens monothéistes, pourquoi s’approprier l’être suprême ? au contraire de prométhée qui partage l’énergie,
sargon d’akkad a existé,
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sargon_d'Akkad
moise un grand doute est permis,
le code d’hammurabi -1600 est antérieur à la table de la loi !
une lecture du livre
https://www.amazon.fr/Comment-Bible-est-devenue-livre/dp/2227474815
il nous faut affirmer que la civilisation européenne a du succès car le croissant fertile a généré de l’étude du monde et socrate a montré la force du doute et de la bienveillance avec son voisin et les lois de la cité, jusqu’à accepter un procès inique et préférer mourir pour respecter sa philosophie
merci socrate de nous avoir fait EUROPE !
Bonjour Laurenty.
Vous devriez lire la Torah d’un point de vue anthropologique, sociologique et psychologique.
Une vraie science, liée a une observation rigoureuse des êtres humains et de leurs comportements.
Le Zoroastrisme, et le Code d’Hammourabi n’ont pas fait mieux dans le genre. Je vais même vous dire que je ne crois pas que quelqu’un ait écrit quelque chose de mieux sur l’espèce humaine.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Cela ressemble beaucoup au livre remarquable de Philippe Nemo « pourquoi l’Occident ? ». Je rajouterai un commentaire personnel : pour que la liberté puisse fonctionner, il faut un fractionnement entre Etats, pour publier dans l’un ce qui est interdit dans d’autres. Dans cet esprit, je pense au domicile de Voltaire qui avait une porte vers la France et une autre vers la Suisse. Un fractionnement des idées, avec les controverses que ça suscite, est également sain: catholiques/protestants par exemple, justement à la Renaissance
Très intéressante réflexion sur un sujet très dense — on voudrait d’autres articles de ce type !
Merci Jean Philippe Delsol (du soleil !)
Une réflexion intelligente, juste, historique, lumineuse à propos de notre humanité.
Notre chère liberté de penser ne devrait jamais se dérober.
La vie est belle !
Historiquement très intéressant , expression d’une culture profonde et ample comme nous aimerions en avoir tous un petit morceau , philosophiquement très riche et source d’une grande réflexion qu’elle alimente mais , car il en faut un, quelle place laisse cette réflexion à l’homme dans la pensée qui le nourrit.
Que de richesses tire-t-on de ce que l’on voit , de ce que nous entendons , de ce que nous ressentons ? N’est ce pas là la source de tout ? La liberté ne se définit pas de la même manière pour tout le monde mais son expression individuelle peut enrichir chacun par la petite lumière qu’elle apporte .
Je crois qu’aujourd’hui ce concept de liberté duquel nous tirons notre force doit s’affranchir des barrières que la civilisation n’a pas manqué de créer au fil du temps et ne peut que se heurter , violemment parfois , aux dictats que quelques têtes pensantes hors sol nous imposent considérant que la Trilatéral est fondatrice d’un nouvel ordre mondial pour le meilleur bien de ceux qui en décident .
Que reste-il donc de cette liberté qui alimenta tant de discours de Platon ?
Cher Monsieur Delsol , j’apprécie vos travaux et vous en remercie , souhaitant que 2025 alimente encore ces moments de réflexions qui nous enrichissent.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
La folle gaieté…
Penser l’Occident sans penser le Christianisme est à mon avis vain… C’est le Christianisme, en la personne de Saint Augustin, qui a découvert la notion du libre-arbitre. Certes, comme le dit si bien Rémi Brague (in “Europe la voie romaine”), l’Occident est allé puiser à Athènes et Jérusalem, mais il ne faut pas négliger la synthèse tout à fait singulière que le Christianisme catholique romain a engendré. D’ailleurs, la Société du Mont Pèlerin aurait dû s’appeler “Tocqueville-Acton society” avant que certains ne protestent de la nommer par deux aristocrates catholiques ! L’école de Salamanque, l’école de Paris et l’école de Vienne, trois pays catholiques, ont été les plus radicales pensées du libéralisme.