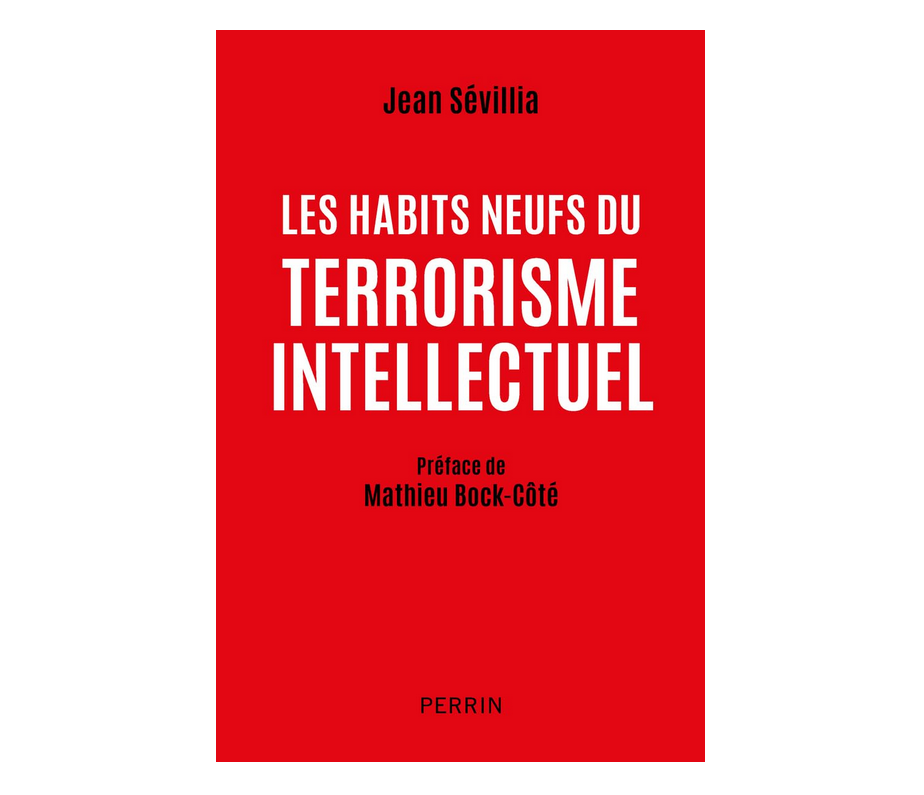L’essayiste, le journaliste et l’historien Jean Sévillia vient de faire paraître une édition largement enrichie et actualisée de son livre fameux initialement paru en 2000, Le Terrorisme intellectuel. Le titre de cette nouvelle édition, Les Habits neufs du terrorisme intellectuel (Paris, Perrin), n’a évidemment pas été choisi au hasard puisqu’il fait directement référence au grand livre de Simon Leys, Les Habits neufs du président Mao (1971), livre dans lequel l’auteur dénonçait la nature totalitaire du maoïsme, alors fort à la mode dans les cercles intellectuels en Occident.
Si le totalitarisme (nazisme et communisme) a disparu au cours du XXe siècle en tant que réalité politique, reste qu’il subsiste bien dans certains milieux politico-intellectuels ce qu’on peut appeler une pensée de type idéologique, voire totalitaire, qui est d’autant plus pernicieuse qu’elle croit sincèrement pouvoir hâter l’avènement du Bien sur terre. C’est d’ailleurs ce que l’essayiste conservateur Mathieu Bock-Côté, qui a préfacé le livre en question de Jean Sévillia, a appelé dans son plus récent ouvrage le « totalitarisme sans le goulag ».
On peut considérer que l’origine du terrorisme intellectuel remonte à 1793, la Terreur étant, écrit Jean Sévillia, la « mère des totalitarismes modernes » (p. 154). Car au temps du comité de Salut public, il s’agissait non pas d’établir l’exactitude des faits mais d’annihiler dans le sang tout désaccord qu’on pouvait avoir avec cette instance gouvernementale… Par la suite, on retrouvera les mêmes mécanismes à l’œuvre au moment du stalinisme, avec par exemple les procès de Moscou. Sous Mao, sous Fidel Castro, les « anticommunistes », qui exigeaient déjà que soit établie la réalité des faits dans les pays communistes, ont été invariablement rejetés dans le camp du Mal – « tout anticommuniste est un chien », disait en 1954 Jean-Paul Sartre, l’une des grandes figures du terrorisme intellectuel au XXe siècle.
On oppose souvent pays démocratiques et pays totalitaires. Or Jean-François Revel avait coutume de dire qu’il peut parfaitement exister au sein d’une société démocratique des segments idéologiques ou totalitaires, dans lesquels une minorité complètement fanatique parvient à s’en approprier les leviers pour imposer d’en haut ses oukases. Les dissidents idéologiques sont alors sommés par les nouveaux inquisiteurs de rentrer dans le rang et de faire pénitence, sous peine d’être excommuniés – on reconnaît ici la cancel culture de notre époque. Revel avait raison, ainsi que l’atteste l’ampleur du sectarisme de l’ultra-gauche « woke », qui en quelques décennies a gagné, depuis les campus américains, des pans de plus en plus larges de la société tout entière. Et comme au temps du communisme, l’idée reste aujourd’hui de faire advenir un « homme nouveau » : celui-ci se doit d’être aujourd’hui « déconstruit », « décarboné », politiquement correct, adepte de l’ « inclusivité » et de la contrition anti-occidentale permanente. À cet égard, le livre de Jean Sévillia montre bien comment le terrorisme intellectuel, loin de s’être essoufflé depuis l’an 2000, a au contraire perduré et s’est même intensifié sous l’empire des nouveaux moyens de communication, en renouvelant l’objet de son combat idéologique.
Cela dit, l’une des différences majeures avec l’an 2000 est que l’époque actuelle semble compter beaucoup plus d’auteurs « conservateurs » qu’il y a un quart de siècle, lesquels n’hésitent d’ailleurs plus à se présenter comme tels. À cet égard, Mathieu Bock-Côté rend hommage dans sa préface à Jean Sévillia, qu’il décrit comme « un des premiers dissidents du régime diversitaire » (p. 18).
Que le lecteur nous permette ici de formuler un point de vue un peu plus général sur le livre de Jean Sévillia. Face à la volonté exprimée par l’ultragauche (et par l’ultra-centre…) de mettre en place ce que Bock-Côté appelle le « régime diversitaire », il faudrait revenir aux yeux des conservateurs à une certaine « identité nationale », qui nous définirait en propre. Or si les conservateurs ont à notre sens raison d’opposer bien des choses à la gauche (bureaucratie, réglementations, étatisme étouffants), s’ils pointent à juste titre les dangers de l’idéologie immigrationniste (à distinguer d’une immigration voulue réciproquement par l’étranger et les personnes qui acceptent librement de l’accueillir au sein de la communauté nationale), et s’ils défendent légitimement l’importance de conserver un patrimoine culturel commun à la nation (langue, littérature, architecture, etc.), reste qu’ils semblent néanmoins obéir à une conception somme toute rigide et prédéfinie de la « nation ». « Qu’on le veuille ou non, écrit Jean-Sévillia, la nation reste la communauté politique la plus ancienne et la plus solide – à condition que l’on en cultive les liens » (p. 222). Certes, mais il faut aussi rappeler que dans une perspective libérale, c’est déjà l’individu qui compte en tant qu’unité sociale fondamentale, si bien que parler de souveraineté – comme le font bon nombre de conservateurs – devrait déjà s’appliquer aux individus eux-mêmes avant de s’appliquer à la nation. Or les conservateurs d’aujourd’hui parlent presque exclusivement de la souveraineté de la nation, jamais de celle de l’individu. Ils montrent par là même qu’ils sont au fond des « constructivistes » de droite, aux prises avec les « constructivistes » de gauche, pour reprendre le mot de l’économiste autrichien Friedrich Hayek, auxquels celui-ci opposait les véritables libéraux. Les libéraux n’ont pas la même vision de la « nation » que les constructivistes, laquelle, nous dit l’économiste Pascal Salin dans son livre Libéralisme (Paris, Odile Jacob, 2000, p. 265), « relève (…) de l’ordre spontané », ce qui la rend donc « multiforme, évolutive et difficile à cerner » (p. 265).
Cela étant, ayons présent à l’esprit le fait que le débat d’idées à propos du rapport à la nation ne saurait se réduire à l’opposition entre « progressistes » de gauche et « conservateurs » de droite : il existe une autre voie, la seule qui vaille d’ailleurs car elle seule repose sur la reconnaissance et le respect absolu des droits légitimes de l’individu : la voie libérale. Ne laissons donc pas aux « conservateurs » le monopole de la définition de la « nation » : tout en étant tributaire d’une culture et d’un patrimoine dont il faut en effet sauvegarder les éléments remarquables, la nation n’est pas pour autant une entité sociale mise sous cloche, figée à jamais. La nation n’est par ailleurs pas l’État, contrairement à ce que pensent bien des conservateurs. Il serait donc temps de refaire confiance aux individus qui composent une même nation, de leur redonner leur liberté et leur responsabilité, que l’État n’a eu jusqu’à présent que trop tendance à leur confisquer illégitimement.