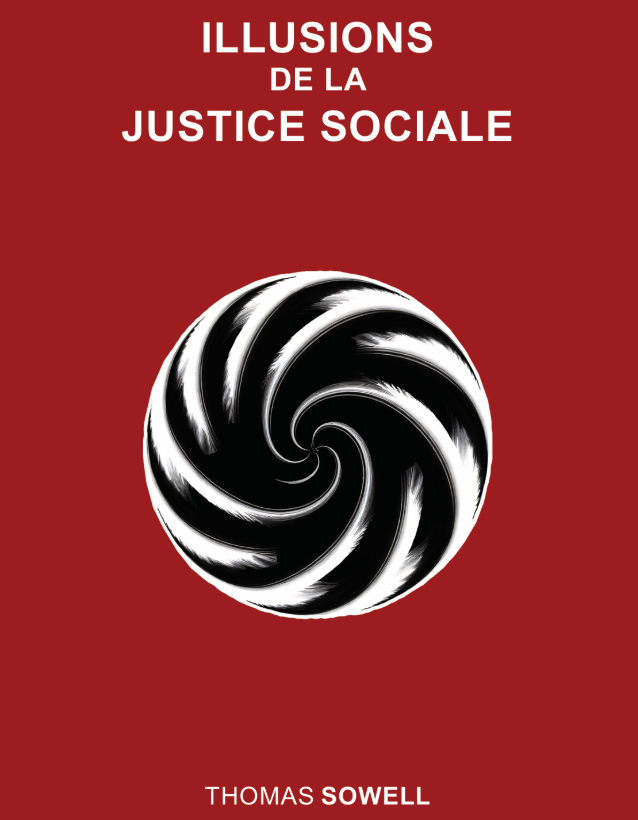Thomas Sowell est un économiste et intellectuel américain de renom, qui a déjà soixante ans de carrière derrière lui. Membre de l’école de Chicago, Senior Fellow du prestigieux Hoover Institute depuis 1980, il s’attaque dans Illusions de la justice sociale (2023 – trad. fr. éditions Carmin, 2025, 248 pages) aux idées reçues qui entourent le concept de « justice sociale ». Le titre est une allusion et un hommage au tome 2 de Droit, législation et liberté de Friedrich Hayek, dont le sous-titre est Mirage de la justice sociale. Le livre de Sowell s’inscrit dans la continuité de son œuvre critique des idéologies égalitaristes et interventionnistes, en déconstruisant les sophismes qui alimentent les revendications contemporaines en faveur d’une redistribution forcée des richesses et d’une égalité artificielle des résultats.
L’ouvrage s’ouvre sur une mise en perspective historique et conceptuelle du terme « justice sociale ». Sowell montre que cette notion, bien qu’omniprésente dans le discours politique et médiatique, manque d’une définition claire et objective. Il souligne comment cette ambiguïté permet à certains groupes d’invoquer la justice sociale pour justifier des politiques arbitraires et inefficaces, sous couvert de morale. Selon lui, la justice sociale n’est souvent qu’un écran de fumée permettant de masquer des intérêts particuliers et une quête de pouvoir.
L’un des axes majeurs du livre est la distinction fondamentale entre l’égalité des chances et l’égalité des résultats. Sowell illustre à travers de nombreuses études empiriques que les inégalités de résultats ne découlent pas nécessairement de discriminations ou d’injustices structurelles, mais sont le fruit de multiples variables telles que les choix individuels, les différences culturelles et les aléas de l’existence.
À l’appui de son argumentation, Sowell convoque des exemples historiques et des comparaisons internationales. Il met en lumière les échecs répétés des politiques de redistribution massive, qui prétendaient corriger les inégalités mais ont souvent abouti à des résultats inverses, pénalisant les plus vulnérables. Sowell rappelle notamment comment certaines interventions gouvernementales ont freiné la mobilité sociale plutôt que de la favoriser, en réduisant les incitations au travail et à l’effort individuel.
L’auteur critique également la posture moralisatrice adoptée par de nombreux défenseurs de la justice sociale. Il montre comment l’émotion l’emporte souvent sur l’analyse rationnelle dans les débats publics, et comment les politiques fondées sur de bonnes intentions produisent fréquemment des effets pervers. En s’appuyant sur la rigueur économique et sur une logique implacable, Sowell appelle à une prise de conscience sur les dangers d’une vision utopique de la société.
Un autre point central du livre est la remise en cause de l’idée selon laquelle les écarts de réussite entre groupes sociaux ou ethniques seraient nécessairement le produit de discriminations systémiques. Sowell démontre que des différences significatives dans les trajectoires économiques existent dans toutes les sociétés et à toutes les époques, indépendamment des structures politiques et juridiques. Il souligne que la réussite repose avant tout sur des facteurs internes aux communautés, comme la culture du travail, l’éducation et les valeurs familiales.
Enfin, Illusions de la justice sociale est aussi un plaidoyer pour la liberté individuelle et la responsabilité personnelle. Sowell met en garde contre l’expansion du rôle de l’État dans la vie économique et sociale, qui tend à créer une dépendance plutôt qu’une émancipation. Il dénonce en particulier la vision angélique d’un John Rawls, qui dans sa Théorie de la Justice, dissimule l’aspect coercitif de toute mesure étatique. Sowell insiste sur le fait que la véritable justice ne réside pas dans des programmes redistributifs coercitifs, mais dans la liberté laissée aux individus de poursuivre leurs propres aspirations, sans ingérence injustifiée.
À travers cet ouvrage, Thomas Sowell ne se contente pas de critiquer les illusions de la justice sociale ; il propose une vision alternative, fondée sur l’empirisme, le respect des faits et la reconnaissance des dynamiques réelles qui façonnent les sociétés. Il invite ainsi ses lecteurs à remettre en question les dogmes dominants et à privilégier une approche plus nuancée et réaliste des inégalités et du progrès humain.
Illusions de la justice sociale s’impose comme un livre essentiel pour quiconque cherche à comprendre les débats contemporains sur l’égalité et la justice. En s’appuyant sur des arguments rigoureux et des exemples concrets, Thomas Sowell offre une analyse percutante qui bouscule les idées reçues et ouvre la voie à une réflexion plus lucide sur les enjeux économiques et sociaux de notre temps.
Fondée en 2021, avec la volonté de rendre accessibles au public francophone des auteurs anglophones majeurs, la maison d’édition Carmin s’inscrit dans une démarche exigeante de traduction et de diffusion d’essais philosophiques. Positionnée sur une niche libérale-conservatrice catholique, Carmin ambitionne de combler un manque dans le paysage éditorial francophone en proposant des ouvrages peu traduits ou méconnus en France. Avec un catalogue en pleine expansion, l’éditeur mise sur une diffusion ciblée, notamment via son propre site internet, et sur des partenariats avec des influenceurs engagés afin d’atteindre un lectorat curieux et exigeant. Prochainement paraîtront les traductions françaises de deux ouvrages du philosophe conservateur Sir Roger Scruton, et celles de trois ouvrages de l’anthropologue américain Ernest Becker, dont son prix Pulitzer 1974, The Denial of Death, réhabilitation de l’héroïsme dans une société décadente.