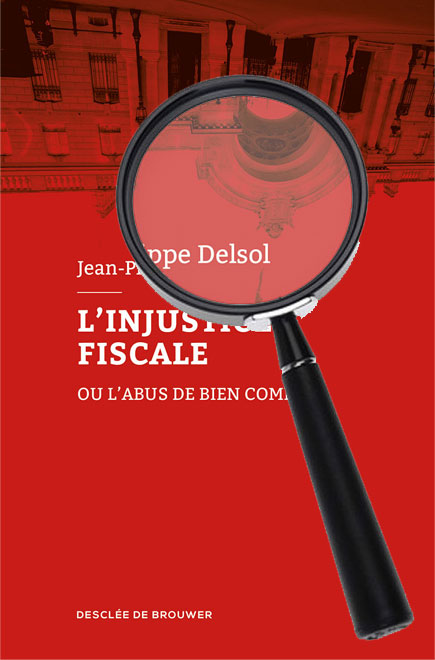Extraits du dernier ouvrage de Jean-Philippe DELSOL, publié chez Desclée de Brouwer, sous le titre L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun.
Acheter en ligne : Fnac | Amazon
Le bien commun est sans doute le fil conducteur de l’énigme du pouvoir. Il est au fondement de sa légitimité lorsque celui-ci est animé par sa juste recherche et de sa déviance lorsqu’il en fait un usage immodéré et pervers. Mais qu’est-ce que le bien commun ?
Chacun le revendique, sous le nom parfois d’intérêt général ou d’intérêt public, pour défendre sa politique. Le bien commun est l’ensemble des règles permettant de vivre ensemble, permettant aussi et surtout à chaque homme de vivre selon ses fins ; mais selon les époques et les régimes, il désigne le cadre restreint des prérogatives régaliennes ou s’étend aux domaines immenses de l’Etat-providence. Celui-ci a progressivement envahi bien des champs d’activité antérieurement laissés à la liberté des individus. Cette montée en puissance de l’Etat est sans doute notamment le fruit d’une confusion du juste et du bien et plus encore du bien et du bien commun, et d’une transfusion inadaptée de la règle d’or du christianisme de la morale choisie par les individus à la règle sociale imposée par la cité. Là où la loi traditionnelle de la société était de ne pas faire à autrui ce que l’on ne voulait pas qu’il vous fasse, le Christ demande à ses disciples de faire aux autres ce qu’ils voudraient qu’on leur fasse. Ce négatif qui devient positif traduit la différence entre la loi et la charité. Mais la sphère publique s’empare peu à peu de ce nouveau terrain d’intervention pour étendre son pouvoir. Et le débat rebondit aujourd’hui tout en se focalisant depuis Rousseau et ses épigones sur le rapport entre les individus dans une obnubilation égalitaire.
Dans ce parcours intrusif où l’individu perd progressivement les libertés qu’il avait acquises de longue lutte, la fiscalité apparaît comme l’outil omniprésent des forces centripètes, le bras armé de la communauté à l’encontre des personnes. L’impôt a toujours été le moyen obligé du pouvoir et de la collectivité pour assurer le bien commun. Mais ils en ont de plus en plus abusé au nom de concepts de plus en plus larges dénaturant le bien commun en intérêt général ou intérêt public qui leur a permis d’intégrer tout et n’importe quoi dans la sphère de leur intervention sans mesurer suffisamment que l’extension de leur activité dépensière se faisait nécessairement avec l’argent des autres, celui des contribuables dont ils empiétaient ainsi sur la capacité d’initiative et la liberté. Ainsi la justice fiscale se trouve entièrement dépendante de la vision du bien commun du collecteur de l’impôt. Juste ou Injuste par rapport à quoi, à qui, à quelles références ?
…
L’obsession maladive de l’égalité
Rawls soumet la bonne justice à une obligation de réduction des inégalités, en définissant le bien suprême comme l’égalité, son libéralisme n’étant en définitive limité qu’à l’acceptation des inégalités dont la suppression n’améliore pas le sort des plus démunis. Il y a là comme une sorte de nouvelle tyrannie qui n’a rien de libérale et selon laquelle des vérités assénées et aléatoires s’imposent à la communauté. Ce pseudo libéralisme est d’ailleurs celui des sociétés occidentales post modernes toutes entières qui se refusent à définir le bien pour mieux asséner leur propre vérité, définir leur modèle de pensée politiquement correct en dehors duquel il n’est point de salut républicain, c’est-à-dire de salut tout court.
…
Le droit, selon Rawls, relève de cette obsession égalitaire que partage désormais le monde occidental sans doute fatigué de s’être si longtemps battu pour faire progresser l’humanité. Elle est relayée par exemple par Arthur M. Okun qui dit : « Abstraction faite des coûts et des conséquences, je préfèrerais plus d’égalité de revenus que moins et j’aimerais encore mieux que tout une égalité totale »[[Equality and Efficiency, the Big Tradeoff, The Brookings Institution, 1975, page 47]], même si A.M. Okun finit par conclure qu’il faut accepter l’inégalité parce qu’elle est efficace. En réalité, il n’accepte l’inégalité que par nécessité et, d’une certaine manière, contre sa moralité, alors que l’inégalité n’est pas morale ou immorale en soi mais elle est le fruit de la liberté qui est morale en soi.
Et pourtant, l’égalité n’est pas le seul fléau possible de la juste balance, elle n’est pas la seule référence possible du droit, mais plutôt une parmi d’autres. La justice pourrait poursuivre le but de respecter les situations ou les patrimoines de chacun plutôt que de les égaliser.
Par ailleurs, et même en admettant qu’il faut accorder de l’importance à l’établissement d’une certaine égalité, comme l’observe Amartya Sen, l’égalité requise comme référent peut être de différents champs : égalité des libertés ou des biens premiers (Rawls), des droits (Nozick), des ressources (Dworkin)… L’égalité recherchée dans un des champs choisi peut créer de l’inégalité dans un autre. Par exemple, l’égalisation des revenus peut se faire au détriment de la liberté de certains individus ou attenter à leurs droits. Finalement, le risque est qu’il soit difficile, voire impossible, de parvenir à un accord sur la nature de la « société juste ». A. Sen prend l’exemple de trois enfants qui se disputent une flûte. Anne la revendique parce qu’elle est la seule à savoir en jouer, Bob parce qu’il est pauvre et n’a pas d’autre jouet, Carla parce qu’elle l’a fabriquée. Selon les principes de l’égalitarisme, il conviendrait de l’attribuer à Bob pour réduire l’écart de ressources qu’il subit avec les autres enfants. Une doctrine utilitariste la donnerait à Anne qui en ferait le meilleur usage et en tirerait le maximum de plaisir puisqu’elle sait en jouer. Mais dans une perspective libérale, la flûte devrait revenir à Carla qui l’a fabriquée. Chaque revendication est fondée dans un système, aucun d’eux n’étant dénué de valeur. Tout n’est pas relatif pour autant.
…
La distinction des ordres : Le juste, le bien et le bien commun
La justice doit s’imposer à tous car elle réunit les règles de vie qui donnent cohésion et pérennité à la société. Mais elle ne peut pas dire le bien qui est éminemment personnel. Tout au plus elle peut concourir au bien commun par l’ordre qu’elle fait respecter et qui est à la base de toute vie commune durable et paisible. Dès lors qu’il est admis que la liberté des individus doit être prioritairement respectée, et dès lors que l’exigence d’autonomie des uns par rapport aux autres est variable des uns aux autres, il est déjà difficile de dicter des règles de justice qui s’imposent identiquement à tous et il est non seulement impossible mais dangereux de vouloir que la collectivité énonce ce qu’est le bien.
…
La référence prioritaire au bien commun est un danger en soi pour l’individu lorsque la notion de bien commun est entendue au sens extensif, comme le bien de la collectivité plus que comme la seule préservation du cadre social pour que chacun y vive librement. «A lui seul, note Jean-Pierre Dupuy, le concept de l’un social implique la nécessité du sacrifice. En référer à la volonté générale, c’est ipso facto dresser l’autel des holocaustes. Le tout social est une divinité implacable qui, dès lors qu’on la nomme ou qu’on la représente, exige son lot de victimes »[[Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale, Hachette, collection Pluriel, 2009, p. 111]]. Un exemple en est donné par Michael Sandel qui demande : « Pour le plus vif plaisir de nombreux Romains, est-on en droit de jeter ne serait-ce qu’un seul chrétien aux lions »[[cité par Jean-Pierre Dupuy, ibidem, p.119]]. Cet utilitarisme pourrait en quelque sorte reproduire au niveau de l’humanité le modèle du bateau en perdition dont les marins affamés tirent au sort celui qui va être mangé pour le bien de tous les autres. Il justifie les représailles à l’encontre de personnes innocentes pour faire cesser les crimes des coupables qui refusent de se dénoncer, il oblige à choisir entre le crime et le crime comme la mère grecque de Camus à qui le SS demande de désigner celui de ses fils qu’il doit fusiller.
…
La question du juste et du bien est au centre du débat sur le rôle du gouvernement et les attributions de la justice d’Etat. Dire juste, décider juste ne peuvent-ils être que bien ? Généralement, mais pas toujours, mais pas forcément pour tous. Et faire le bien n’est pas toujours juste. Le Bien de la Cité peut s’opposer au bien des citoyens ou de quelques-uns d’entre eux. Lorsque le gouvernement décide de la guerre pour défendre le pays, c’est au détriment de la vie de ses soldats. Lorsque la ville limite la circulation des voitures, c’est une contrainte pour les automobilistes. Ces décisions peuvent être justes, prises pour sauvegarder des biens ou des valeurs supérieures, mais à l’encontre de biens particuliers. L’impôt à cet égard est l’outil par excellence de la justice et de la spoliation à la fois. Il prélève dans la poche des particuliers pour défendre des valeurs collectives, il fait mal à ceux qui le payent pour contribuer à des dépenses décidées pour un certain bien commun. Mais qui décide du bien commun ? Et si l’Etat reste indifférent au bien commun, faut-il que des âmes généreuses s’en chargent à sa place ? Robin des bois avait-il le droit de voler Jean sans Terre pour redistribuer aux pauvres ?
La justice est d’abord ce qui permet de donner ou rendre à chacun ce qui lui revient, de partager ou d’attribuer selon les règles reconnues ou admises consensuellement. Elle est l’objet et l’essence du droit au point que le mot latin confond le droit et le juste : Jus, id quod justum est. Le droit est ce qui est juste. Le droit est l’expression de la justice, indépendamment du juge. Celui-ci ne vient que sanctionner la violation du droit.
A cet égard, la justice est une activité objective, du moins elle devrait l’être autant que possible. Rendue par des hommes, elle est naturellement imparfaite et parfois partiale. Mais dans le principe, elle devrait être dépersonnalisée, c’est à dire qu’elle ne devrait pas tenir compte de l’agent ou de sa situation ou de sa condition. Un acte est juste ou ne l’est pas. En ce sens la justice est distincte de l’équité qui vient la tempérer, l’adoucir du regard des hommes sur leur prochain.
La justice n’est pas compassion ou sentiment. Elle doit respecter les droits de chacun pour que chacun ait son dû. Déjà Xénophon avait ce souci. Il l’énonçait en donnant le récit de l’éducation de Cyrus, le grand roi des Perses qui racontait lui-même : « …le maître, voyant que je connaissais bien la justice, m’avait donné mission de juger les autres. Et même un jour je reçus des coups pour n’avoir pas bien jugé. Voici quelle était l’affaire. Un enfant grand, qui avait une petite robe, déshabille un enfant petit qui avait une robe grande, lui met la sienne et se revêt de l’autre. Chargé de les juger, je décide qu’il vaut mieux que chacun d’eux ait la robe qui lui va. Alors le maître me frappe en disant que, quand je serais nommé juge de ce qui convient ou non, il faudrait juger comme j’avais fait, mais que, puisqu’il fallait décider auquel des deux était la robe, je devais considérer si celui qui l’avait prise de force devait plutôt l’avoir que celui qui l’avait faite ou achetée. Il ajoutait que ce qui est conforme aux lois est juste, tandis que ce qui est contraire aux lois est tyrannique, et il voulait que le juge donnât toujours un suffrage conforme à la loi. Ainsi, ma mère, je sais parfaitement à présent. ce qui est juste … »[[Xenophon, Livre I, Chapitre III, 16, 17 De la Cyropédie]]. Libre ensuite aux protagonistes d’échanger leurs tuniques, mais ce n’était pas au juge de le faire. Lui devait remettre à chacun le sien selon la loi ou le droit.
Au demeurant la justice est toujours établie à partir de faits. Elle ne saurait être une construction in abstracto, mais plutôt une lente élaboration, une maturation de l’observation sociale permettant de définir des règles de vie, des critères de jugement commun qui tout à la fois assureront le respect mutuel et le moyen de vivre ensemble. Elle est un équilibre fragile entre les passions des hommes et leur raison, entre leur nature quasiment immuable et le changement perpétuel et incessant de leurs exigences et de leur vision du monde. Elle est ancrage et adaptation prudente et mesurée. Elle est tradition et modernité. Elle est cet impossible éternel, cet état désiré et inaccessible à l’état pur, une quête sans laquelle l’homme ne serait pas vraiment homme car c’est son destin sans doute d’être en marche dans l’inconnu vers un meilleur enchanteur et peut-être inaccessible. Il ne trouvera sans doute jamais la justice sur terre, mais il peut l’approcher, améliorer toujours les lois qui le gouvernent, croire à son destin pour aller au-delà des limites antérieures. A cet égard, la justice est tendue vers le bien commun, elle est la règle sur laquelle s’ordonne la vie sociale, qui permet le bien commun comme bonne vie ensemble, et qui permet à chacun de faire le bien qu’il n’appartient pas à l’Etat de faire à sa place. Cette règle s’élabore elle-même autour de quelques principes auxquels convient de se référer la sagesse du législateur, dont les lois doivent suivre ces principes, et la prudence des magistrats appelés à appliquer ces lois et principes aux cas particuliers. La justice contribue au bien commun, c’est-à-dire à l’accomplissement du bien public, du bien vivre des citoyens ensemble. Elle en est l’artisan, elle œuvre et répond au désir de bien vivre ensemble. Le but du législateur n’est pas de rendre les hommes bons, car ce but est celui des pouvoirs spirituels, mais plutôt de rendre possible la coexistence entre les hommes, de leur permettre d’accéder à un bien terrestre en surmontant autant que possible leur indigence et leurs insuffisances qui les ont conduits à s’associer pour être plus forts. La justice à cet égard n’est pas une construction abstraite, mais plutôt le fruit d’une analyse rationnelle à partir de l’observation des hommes et de leur histoire, la reconnaissance par la raison de ce qui est meilleur pour les hommes et de ce qui est mauvais pour eux. Le bien commun est précisément l’ordre social qui permet au mieux aux membres de la communauté politique de trouver les moyens adéquats à leur accomplissement personnel. La justice qui assure l’égalité des échanges favorise la cohésion de la société en faisant vivre une communauté d’intérêts de manière réciproque et juste.
Le Bien est autre chose, il est la quête ultime de l’homme. Le Juste peut tendre au Bien, mais il ne saurait s’y substituer. Le Bien est presque de l’ordre du divin en ce sens que la bonté pure ressort de la perfection. Le souci de la bonté revient à chacun, la bonté est essentiellement privée ; elle est aussi relationnelle, comme la justice, mais elle relève des rapports humains quand la justice appartient à l’ordre public parce qu’elle permet aussi d’éviter le désordre social. La bonté est unilatérale, elle se donne quand la justice est toujours issue peu ou prou d’un échange.
…
Le juste ne peut pas être au service du mal, mais le bien est d’une autre nature. Le juste est ce qui tend à remettre à chacun le sien, ce qui lui revient ; le juste attribue, partage ou départage. Le bien est ce vers quoi chacun tend pour réaliser sa propre nature et à ce titre chacun a besoin d’abord de sa liberté. Le juste doit donc d’abord respecter la liberté de chacun, pour permettre à chacun de réaliser son bien.
La doctrine moderne rétablit les droits de l’individu et les fait primer sur ceux de la société. C’est le renversement opéré par les nominalistes et poursuivit jusqu’au XXème siècle ; mais chaque fois, ou presque, le particulier n’est valorisé et la priorité ne lui est donnée que pour le soumettre bientôt au Tout, sous une forme ou sous une autre, pour un prétexte ou pour un autre. Indépendamment même du collectivisme qui se fait une doctrine de la dissolution de l’individu dans la masse, la théorie trouve toujours une raison en forme d’excuse pour que l’Homme abandonne sa liberté et jusqu’à sa rationalité à la société, de Hobbes à Rousseau, de celui-ci à Rawls. Le dernier avatar de ce grand abandon est plus subtil et plus sournois, il est dû à une sorte de poison que les Hommes ingèrent volontairement pour se livrer librement à un nouveau Léviathan qui impose, au travers des médias autant que de la culture ou des lois et de la jurisprudence de juges acquis à la nouvelle doxa, des comportements conformes, standardisés, politiquement corrects en dehors desquels il n’est point d’avenir, point de salut, point même seulement de liberté d’agir, d’être, de vivre.
Au fond, c’est l’ancienne doctrine du bien commun comme supérieur au bien particulier et déterminant du juste qui s’impose à nouveau. Là où elle faisait l’objet d’une acceptation consensuelle liée par une communauté de vie et de religion, elle est désormais le fruit d’un autre ralliement à une philosophie de l’égalité d’une part et à une conception libertaire de l’individu d’autre part, une forme de religion laïque en quelque sorte qui veut à son tour utiliser tous les ressorts de la société, et surtout la loi, pour contraindre chacun à se plier à ses normes, à se comporter comme elle l’entend. Mais entre l’ancienne et la nouvelle doctrine, l’écart est immense parce que la nouvelle doctrine s’exerce soi-disant au nom de la liberté des personnes qu’elle soumet plus que jamais à sa loi, alors que l’ancienne doctrine affichait ouvertement que la collectivité primait sur les individus. La fiscalité en est le témoin et l’outil privilégié qui veut, en France plus qu’ailleurs, raboter les revenus et les patrimoines pour sacrifier au nouveau veau d’or qu’est l’égalité sur l’autel de laquelle Rawls, l’auteur présumé de référence en matière de justice, est censé avoir définitivement sacrifié.
…
Et lorsque l’Etat se substitue aux individus pour faire le bien, c’est-à-dire prétend faire le bien des autres, ou obliger chacun à faire le bien, il prend un immense risque, le risque d’imposer un bien qui n’en est pas un. A vouloir faire le bien des autres malgré eux, il n’est pas rare de leur faire le plus grand mal. Ce ne peut donc être qu’avec d’infinies précautions, la main tremblante, que l’Etat peut s’engager dans cette voie hasardeuse du bien des autres. Lorsque la loi veut entrer dans le domaine de la morale, lorsqu’elle ne veut pas seulement protéger la propriété, mais la répartir, non seulement protéger la vie des uns et des autres, mais obliger à favoriser le bonheur de tous, lorsqu’elle veut régir les rapports entre parents et enfants, supprimer la charité au profit de la seule justice, …elle prend le risque qu’à défaut de propriété garantie, tous soient plus pauvres, qu’un bonheur imposé soit le malheur de beaucoup, que les enfants ne soient plus éduqués… Car le législateur ne saurait se substituer aux individus pour savoir ce qu’ils veulent comme bonheur, il ne peut être parent à la place des parents, il ne saurait faire prospérer la propriété aux lieu et place des propriétaires.
…
La bienveillance est une qualité, mais pas celle qu’on attend d’un gouvernement. Un gouvernement doit gouverner, pas être bienveillant. Une ONG doit être bienveillante si c’est dans sa vocation, une Eglise doit l’être parce qu’en principe cela relève de sa mission…Il s’agit donc de naviguer sur une crête étroite, tout à la fois de permettre que la société dispose d’un cadre suffisamment stable, clair, acceptable par le plus grand nombre, pour que la vie sociale soit possible, mais aussi que ce cadre ne soit pas étouffant, pas oppresseur, pas liberticide. Il s’agit que la collectivité définisse ce qu’il ne faut pas faire pour tuer la collectivité sans laquelle l’homme ne serait plus qu’un loup pour l’homme, sans garde-fou, sans repos pour vivre. Il faut qu’elle laisse à chacun le droit et même qu’elle favorise l’exercice de sa liberté, qu’elle laisse à chacun la possibilité de faire plus que de s’abstenir, d’aller au-devant des soucis de ses contemporains, d’adopter s’il le veut des préceptes évangéliques. Mais ce sont deux ordres différents entre lesquels le danger extrême est que l’un empiète sur l’autre, que l’ordre social se fasse compassionnel, qu’il veuille utiliser ses immenses moyens pour faire le bien qu’il n’appartient qu’à chacun de nous de vouloir et de faire ou de refuser de faire.
En réalité c’est même quand la société a compris que ce qu’elle appelait le bien commun avait plus de chance d’advenir par la liberté des individus que par l’action de l’autorité que le Progrès a fait des progrès fulgurants. Le progrès économique a été rendu possible par le fait qu’à partir d’un certain moment, les entrepreneurs ont été reconnus par la société et que la fonction d’entrepreneur est devenue désirable, non seulement pour l’argent qu’elle procurait mais aussi pour la reconnaissance qu’elle permettait d’en obtenir. Ils ont ainsi pu contribuer au bien commun de manière individuelle, en créant des produits nouveaux et incomparables pour satisfaire aux besoins de l’humanité.
La vraie bienveillance n’est pas universelle, mais le fruit de l’attention de chacun à d’autres que soi ; elle n’a rien d’obligatoire sauf à devenir autre chose que de la bienveillance, tout au plus une obligation d’assistance à personne en danger. La bienveillance n’est bienveillance que par et dans le libre choix des individus tant à l’égard des personnes que des modalités retenues pour l’exprimer. Cela ne signifie pas que la bienveillance ne peut pas relever d’une forme d’obligation morale personnelle. Mais l’Etat ne peut pas se l’arroger et surtout l’imposer à tous.
…
Hayek a repris la formule d’Adam Ferguson selon laquelle l’ordre collectif est le « résultat de l’action des hommes, mais non de leurs desseins »[[ibidem]]. Il n’y a pas de constitution de la société par un contrat, fut-il fictif, mais par un mouvement naturel créé par les choix rationnels des individus qui bénéficient eux-mêmes de toute la tradition trouvée à leur berceau et représentant ce que la société a accumulé jusqu’à eux de savoir et savoir-faire, d’apprentissage automatique transmis, parfois presque mécaniquement, et qui évite d’avoir à repenser l’entièreté du monde à chaque naissance. Cet ordre est spontané et presque involontaire. Analysant la fable des abeilles de Mandeville, Hayek écrit encore que « dans l’ordre complexe de la société, les résultats des actions des hommes sont très différents de ce qu’ils ont voulu faire, et les individus, en poursuivant leurs propres fins, qu’elles soient égoïstes ou altruistes, produisent des résultats utiles aux autres qu’ils n’avaient pas prévus et dont ils n’ont peut-être même pas eu connaissance ; en fin de compte, l’ordre entier de la société, et même tout ce que nous appelons la culture, est le produit d’efforts individuels qui n’ont jamais eu un tel but, mais ont été canalisés à cette fin par des institutions, des pratiques, et des règles qui n’ont jamais été délibérément inventées, mais dont le succès a assuré la survie et le développement “[[ F.A. Hayek, “Lecture on a master mind : Dr Bernard Mandeville“, Proceedings of the British Academy, vol 52, 1966 ; repris dans New Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas, Londres et Chicago, 1978, p.253]].
…
Pour atteindre à la justice, il faut comparer les situations, rechercher ce qui doit revenir à chacun. A cet égard, le droit n’est pas dit d’avance ; il appartient au juge de le prononcer après avoir pesé les situations en y procédant avec prudence. Ces solutions construites au cas par cas font jurisprudence. Le droit n’est pas figé car les lois naturelles qui y président ne sauraient être connues de manière définitive et complète ; elles se découvrent par le travail des juges qui tâtonnent dans cet exercice. La tradition ne saurait être figée. C’est le rôle du droit de la respecter et l’enrichir, de l’évaluer et le cas échéant de la tailler. Les juges accouchent du juste comme d’un travail de découverte qui retient les lois connues, les précédents appris et évaluent leur application aux cas présents selon le lieu, le moment et les personnes en présence. Le droit est souvent matière à compromis, à équilibre, à arbitrage, à concession et à ce titre il exige un art de la recherche, de la réflexion critique. Comme l’a expliqué Michel Villey, il faut traduire la formule des stoïciens pour lesquels « Jus suum cuique tribuere » non pas par « rendre à chacun ce qui lui est dû », mais plutôt par « attribuer », voire « découvrir » « ce qui revient à chacun ».
La cité est d’abord faite pour le bien des hommes, elle gère la justice en veillant que revienne à chacun ce qui lui est dû, et non seulement en termes matériels, mais aussi en termes de respect. Et la cité doit le respect à chaque individu comme chacun doit le respect à chacun et à la cité qui y veille.
…
Le bien ne saurait donc être celui de la collectivité sans être d’abord subordonné au bien des individus que la collectivité a devoir de faire respecter puisqu’elle a été constituée à cet effet. Le juste est donc naturellement lui-même ordonné aux fins pour lesquels les hommes se sont associés et dès lors ne saurait être mesuré autrement qu’à l’aune du respect de la liberté et de la propriété des citoyens. Certes, Locke évoque «la tranquillité, la sûreté, le bien du peuple » comme la fin du gouvernement, mais comme le moyen de permettre précisément l’exercice par chacun de ses libertés et l’usage de ses propriétés. Ni le pouvoir, ni la loi ne peuvent donc attenter à la liberté et à la propriété qu’ils ont été chargés de défendre et qu’ils n’ont pour fin que d’assurer la conservation. Ainsi l’autorité
« n’a point le droit de se saisir d’aucune partie des biens propres d’un particulier, sans son consentement. Car, la conservation de ce qui appartient en propre à chacun étant la fin du gouvernement, et ce qui engage à entrer en société, ceci suppose nécessairement que les biens propres du peuple doivent être sacrés et inviolables »[[Ibidem, chapitre IX, 138]]. L’autorité ne retrouve le droit de restreindre la liberté et la propriété que pour concourir au bien être de la communauté. Mais ce droit, qui peut ouvrir à tous les abus, s’exerce sous le contrôle de tous.
…
Le préalable de la liberté
La liberté n’est pas une fin en soi, mais plutôt la condition nécessaire ou du moins très souhaitable pour que chacun atteigne sa fin. Car l’homme ne peut pas être responsable de sa fin sans disposer de la liberté de ses actes et de ses pensées. L’Homme n’est pas vraiment homme s’il n’est pas responsable de lui-même ; c’est ce qui en fait un animal différent des autres. Il n’est pas seulement un animal social…
La liberté n’est pas une fin première, mais plutôt une fin seconde en ce sens qu’elle est non seulement utile, mais indispensable au plein épanouissement de l’Homme parce qu’elle est nécessaire à l’exercice par lui de son discernement, de sa capacité de choix, de sa responsabilité, mais qu’elle n’est pas à rechercher pour elle-même. Elle est toujours au service de quelque autre valeur ou vertu, elle est la condition préalable mais pas la fin en soi. Et néanmoins, la liberté est aussi constitutive de l’Homme, elle lui est consubstantielle en ce sens que sans liberté, il n’y a pas d’humanité. Cette liberté est parfois réduite à presque rien, à la liberté de penser au fond d’un cachot, mais elle est, là plus que jamais, la manifestation de l’humanité qui reste ce brin de vie libre contre vents et marées, contre peine et prison, capable de se battre « contre toutes les tyrs et toutes les sodomes ». Elle est la flamme qui veille encore, même vacillante, quand plus rien ne paraît encore possible ; elle fait tenir l’homme debout parce qu’elle est son espoir, plus même, l’espérance qu’il peut encore capter au-delà de ses ténèbres. La liberté est le ressort de son sursaut lorsqu’il lui est refusé tout droit ou qu’au contraire il est assisté jusqu’à l’infantilisation, cette forme moderne du despotisme archaïque que représente l’Etat-providence. La liberté appartient à la nature de l’Homme non pas comme un donné, mais comme un combat. Elle lui est constitutive non pas parce qu’il la possède, mais parce qu’il lui est propre de pouvoir la gagner, tous les jours, de la défendre pour lui et pour les autres, de se l’approprier par ses qualités humaines et d’en vivre. Elle est l’esprit qui a animé l’humanité en marche, qui a permis son progrès toujours en avant malgré ses querelles et ses échecs. Elle est, plus encore, la condition et le moyen pour chacun, individuellement, de grandir dans son humanité.
La liberté responsable
…
La justice s’est perdue en laissant la société être happée par l’Etat, modelée par la main qui a voulu la protéger. En 30 ans, les dépenses sociales ont augmenté de plus de 50% en pourcentage du PIB (Produit Intérieur Brut) en France. C’est le signe de la croissance incessante de l’Etat prévoyance dont la charge n’est plus désormais ni maîtrisée ni supportable. Mais dans une Europe qui, dit Angela Merkel, « représente 7% de la population mondiale, 20% de la production et 50% des dépenses sociales », la France est désormais, en 2015, championne toutes catégories. Selon l’OCDE celle-ci consacre 60% de ses dépenses publiques au secteur social, soit 33% du PIB contre 26,2% pour l’Allemagne ou 23,8% pour l’Angleterre, et 22,1% pour la moyenne OCDE.
Cette dérive ancienne est le fruit d’un excès de bienveillance de l’Etat doublé d’une démagogie facile tendant à multiplier les prébendes, notamment à la veille des élections. Mais elle a été particulièrement favorisée par la modification progressive du mode de financement de ces dépenses. Le déplafonnement des cotisations, l’instauration d’impôt sociaux (la CSG/RDS en France) et la prise en charge d’une part de plus en plus significative des dépenses sociales par les budgets de l’Etat ou des collectivités locales ont fait que les assurances sociales ne sont plus des assurances, mais des dépenses de redistribution sociale. Plus personne n’en mesure le coût et aucun de leurs bénéficiaires n’a plus intérêt à en limiter la dérive. Ainsi les charges sociales, employeur et employé, ont grimpé sans cesse pour atteindre plus de 80 % du salaire net quand elles sont de l’ordre de 25 % dans de nombreux pays comme la Suisse ou l’Angleterre. Chacun cherche alors naturellement à se défausser sur les autres. Le patronat demande que les milliards (35 en 2014) qui financent la branche famille soient payés par d’autres impôts tels qu’une augmentation de TVA ou de CSG. Les salariés réclament une hausse des cotisations supportées par les employeurs. Le débat sur les retraites s’installe dans la médiocrité entre ceux qui veulent allonger la durée de cotisation et ceux qui souhaitent reculer l’âge de départ en retraite. Pour limiter le dérapage incontrôlé du budget de la sécurité sociale, les listes s’allongent, année après année, de médicaments et autres prestations non remboursés. Mais c’est emplâtre sur jambe de bois. Il ne s’agit toujours que de remplir plus le tonneau des danaïdes de ce gouffre social en augmentant indûment les prélèvements sociaux et fiscaux.
A la fin, c’est l’esprit des Français qui est collectivisé. Ils trouvent normal que tout soit gratuit sans comprendre que ce qui est gratuit coûte généralement très cher. Chacun pense qu’il ne paye pas ce qu’il paye doublement autrement, par des impôts excessifs et par des services imposés et trop souvent peu performants.
…
Qui trop embrasse mal étreint dit le proverbe. C’est vrai de l’Etat-providence qui à trop grossir risque de se pervertir avant peut-être d’éclater comme la grenouille. Il risque surtout et plus encore de rendre un mauvais service à ceux qu’il veut assister, de les droguer d’assistance, de les fragiliser au lieu de les renforcer, de les diminuer au lieu de les grandir.
…
La justice peut se mesurer à l’aune de la liberté réelle laissée à chacun d’atteindre ses fins, de s’accomplir en les accomplissant. Et dans la mesure où il ne peut non plus être question que l’Etat, le pouvoir quel qu’il soit, décide des fins de chacun à la place de chacun sans remettre en cause le fait qu’il s’agit précisément de la fin de chacun, le seul rôle de la collectivité pourrait être en fin de compte, -devrait être même-, de favoriser l’autonomie de chacun dans le respect de la liberté d’autrui, c’est-à-dire d’encourager l’exercice par chacun d’une liberté responsable.
Certes un critère peut être un guide, un repère, mais il ne peut pas être, en la matière du moins, une clé universelle. La liberté est un outil à manier avec précaution et tous ne savent pas s’en servir. Certains n’en ont pas l’usage. L’autonomie des uns peut limiter celle des autres, et il est généralement très difficile de mesurer l’autonomie de chacun. Il peut exister également des cas dans lesquels la personne n’est pas capable d’autonomie ou de complète autonomie. L’utilisation de ce critère pourrait permettre de justifier des mesures de justice distributive quand elles sont nécessaires, mais avec « la main qui tremble », en en limitant naturellement l’importance, le coût et la charge pour la collectivité.
Ceux qui prennent les hommes pour des marionnettes, ceux qui croient encore à un Etat omniscient et omnipotent ont perdu la main parce que depuis des décennies qu’ils disent qu’il faut augmenter les dépenses publiques pour sauver l’emploi et améliorer le niveau de vie des Français, le chômage augmente et la croissance baisse. La société est faite de nos millions de décisions qui s’entrecroisent et construisent ensemble un tissu social plus fort que celui que les manipulateurs d’en haut, prétentieux ignorants de la réalité d’en bas, voudraient construire malgré nous. Et pour réformer le vieil Occident malade de sa paranoïa étatique, il est temps de redonner l’initiative, la responsabilité et la liberté à tous ceux, innombrables, qui ont des idées et du courage, aujourd’hui étouffés par une hydre étatique et administrative. La recherche de l’autonomie devrait ainsi pouvoir présider à toutes les décisions concernant l’action publique, aussi bien pour l’école que pour l’emploi, pour l’immobilier que pour la culture.
Rendre chacun responsable de son destin, de sa vie, c’est non seulement le seul moyen de retrouver à long terme un meilleur équilibre dans la répartition des fruits du travail et de l’épargne entre ce qui revient à la collectivité et ce qui reste à chacun, mais c’est aussi et surtout le moyen de redonner à chacun l’envie, l’espoir et la fierté d’améliorer son sort par lui-même.
…
Acheter en ligne : Fnac | Amazon