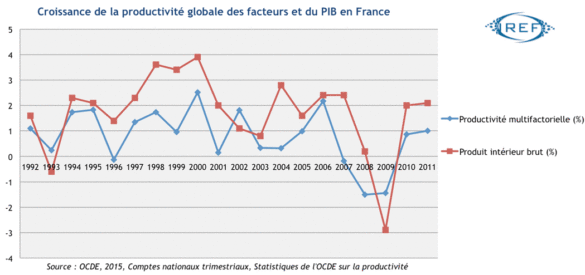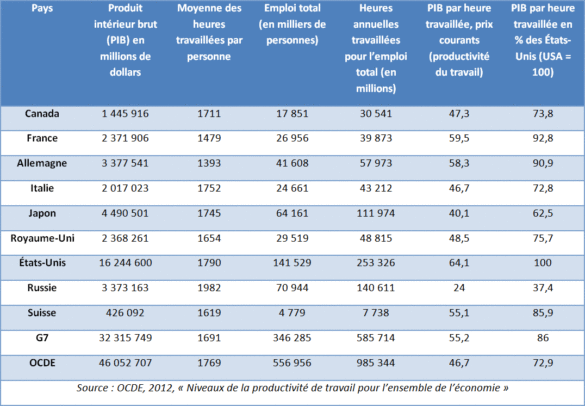The Economist soulève comme à son habitude un débat tout à fait intéressant dans un article publié le 14 mars (« Bargain Basement« ). Selon la revue d’orientation libérale, le Royaume-Uni souffre d’un retard de productivité horaire qu’il attribue à la politique de déflation salariale pratiquée par les entreprises britanniques. Il en conclut indument que le Royaume Uni devrait à ce titre s’inspirer du modèle français. Historiquement l’accroissement de la productivité du travail a toujours été lié à des périodes de forte croissance économique. Or, s’il est vrai que le Royaume-Uni a connu une croissance rapide à la suite des réformes économiques menées par le gouvernement de David Cameron (le taux de croissance a atteint 3 % en 2014, soit environ 7 fois supérieur à la croissance française), la production par heure travaillée reste considérablement inférieure au niveau français. Toutefois, The Economist passe à côté d’éléments d’analyse majeurs et de données statistiques que nous allons détailler pour tenter de démontrer que le modèle français n’est clairement pas la voie à prendre.
La courbe de la productivité est pratiquement la même en France et au RU entre 1992 et 2011
Tout d’abord, la productivité peut se définir comme le calcul de l’efficience d’une production évaluée en termes monétaires. Plus spécifiquement, la productivité se calcule généralement comme la contribution des facteurs de production (le travail et le capital) à un volume quantitatif tel que le produit intérieur brut (PIB). La productivité du travail, sur laquelle se focalisent l’article de The Economist et l’article présent, est une productivité unifactorielle, c’est-à-dire la contribution du seul facteur travail à la mesure de la production nationale. La productivité combinée du travail et du capital, que l’on nomme la productivité globale des facteurs ou productivité multifactorielle, est généralement considérée par la communauté des économistes comme la principale source de la croissance économique, de l’emploi et de la compétitivité d’une économie.
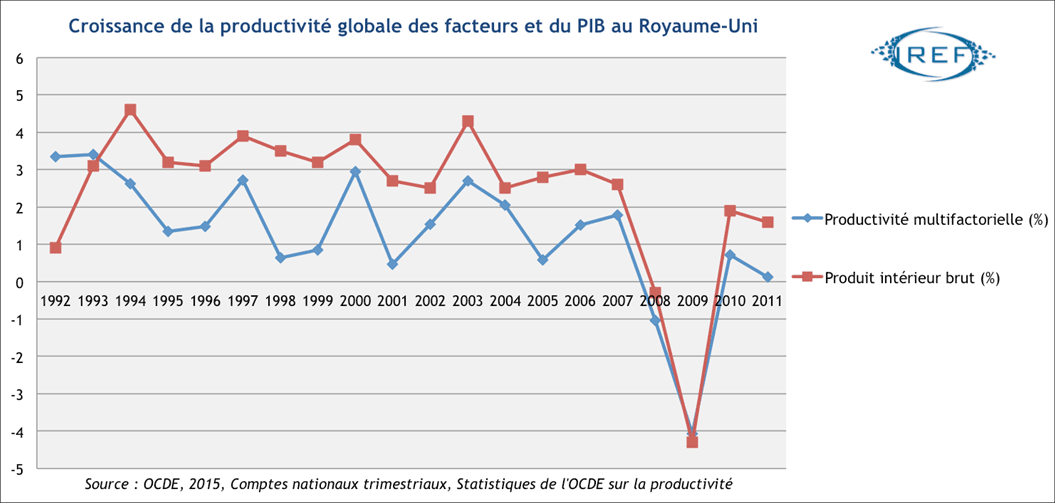
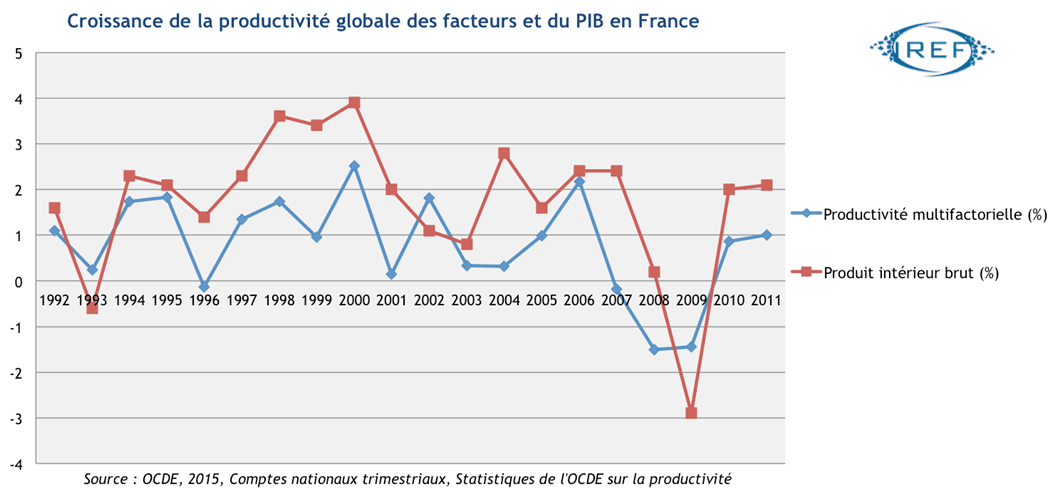
Comme on peut le constater sur les deux graphiques ci-dessus, la courbe de croissance de la productivité globale des facteurs de production suit une courbe assez semblable à la courbe de croissance de la production nationale, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, dans la période 1992-2011. Évidemment, cette corrélation statistique forte entre productivité des facteurs et croissance se vérifie de manière quasi-systématique dans les données disponibles. C’est pourquoi il est important de mesurer si les entreprises nationales réalisent des gains de productivité par le biais de l’accroissement des investissements en capital circulant comme les matières premières ou en biens d’équipement tels que des machines, des outils ou des ordinateurs ou au travers du progrès technique, d’une meilleure gestion des ressources humaines et de l’information ou encore d’une augmentation de la force de travail disponible.
Productivité horaire et facteurs exogènes
(temps de travail, marché noir, structure de production, etc…)
Nous allons spécifiquement nous intéresser à la productivité horaire du travail, qui est un composant essentiel de la production – les salaires ayant représenté historiquement environ les deux tiers de la valeur ajoutée de la production selon les économistes [1]. La productivité horaire moyenne du travail dans les pays du G7, mesurée en dollars constants, évolue entre $41,5 et $48,8 entre 2001 et 2013 (voir graphique ci-dessous). Le Royaume-Uni oscille sur la même période entre $39,3 et $45 avec une tendance baissière à partir du déclenchement de la crise économique et financière de 2008. La France se situe alors entre $45,4 et $50,9 avec un accroissement soutenu de la productivité à partir de 2009, malgré une croissance atone ; et l’Allemagne suit à peu de choses près la même tendance. À la pointe du classement, les États-Unis voient leur productivité horaire grimper de $46,8 à presque $57 dollars avec une tendance haussière presque linéaire qui n’a même pas ressenti l’impact de la crise de 2008. À la traîne, la Russie, qui ne fait toutefois pas partie du G7, a une productivité extrêmement faible qui évolue entre $10,3 et $15,6 – mais cela représente une croissance de la productivité qui approche les 50 %, ce qui pourrait expliquer les forts taux de croissance connus par le pays sur cette période. Il est également intéressant de noter que malgré l’importance de son développement technologique et du haut niveau de qualification et de compétence technique, le Japon a le niveau de productivité horaire le plus bas du G7, entre $31,1 et $36,1, toujours sur la même période. Enfin, la Suisse, dont les performances sur les fondamentaux économiques ne sont plus à démontrer, est assez proche de l’évolution de la productivité horaire britannique, entre $40,1 et $44,5.
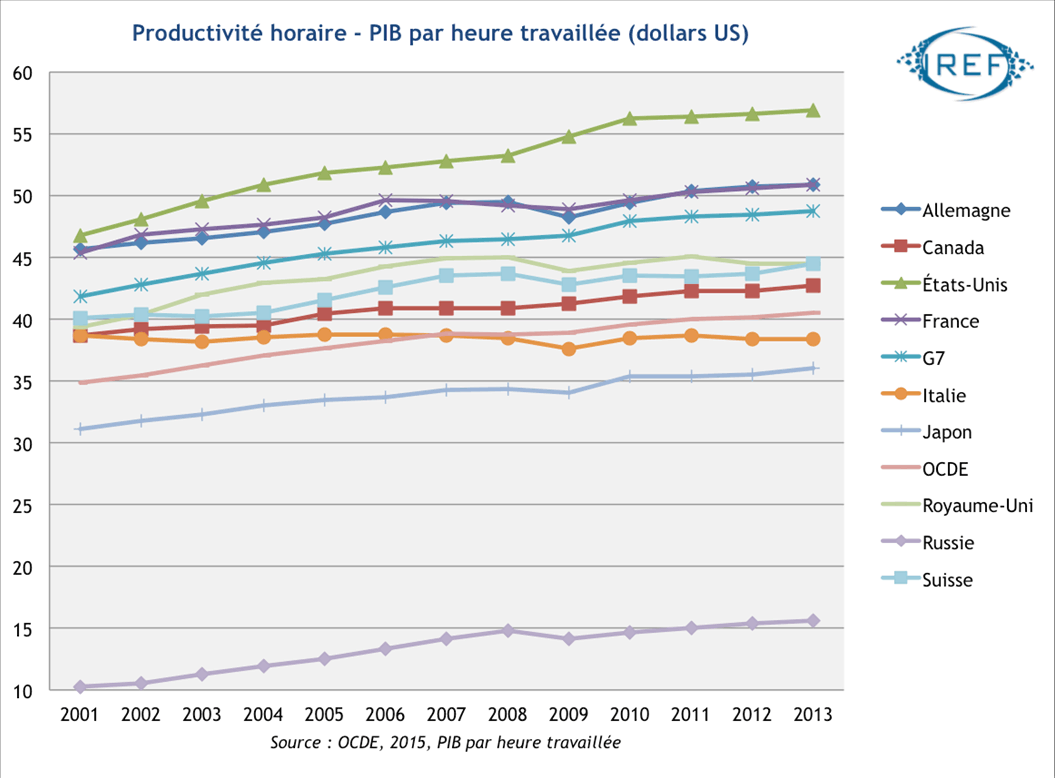
Il nous paraît donc justifié d’observer la mesure statistique de la productivité horaire avec un certain recul, en tenant compte de l’impact des multiples facteurs exogènes qui façonnent le niveau de productivité – on peut par exemple citer la durée hebdomadaire légale du travail, l’importance du marché noir du travail, le salaire nominal horaire moyen, la structure de production, le niveau de qualification, le degré de compétence et de savoir technique, la contribution du facteur technologique et informationnel ou encore la qualité du management des ressources humaines. C’est pourquoi l’analyse de The Economist, se limitant à un simple regard sur le niveau nominal de productivité horaire par le biais du coût du travail, sans évaluer les multiples facteurs exogènes qui influencent la productivité du travail, manque d’une vision globale que nous allons essayer de compléter.
Le coût du travail et le SMIC pénalisent la France
Tout d’abord, les coûts unitaires de main d’œuvre, c’est-à-dire le coût moyen du travail par unité produite, ont connu une progression soutenue entre 2010 et 2014 en Allemagne, au Canada et aux États-Unis (entre 6 et 9 % d’augmentation). Le Royaume-Uni a quant à lui suivi une courbe relativement similaire à la France, avec une augmentation légèrement supérieure à 5 % en 4 ans. Le Japon, qui a connu une replongée dans une période déflationniste à partir de 2009, a suivi une trajectoire de baisse régulière du coût de travail avant de connaître un renchérissement en 2014. Ce que nous apprend la théorie économique, c’est qu’un renchérissement du coût du travail réduit mécaniquement l’offre de travail, tout en incitant les entrepreneurs à investir davantage dans le facteur capitalistique pour améliorer le rendement de la production et rétablir l’équilibre du ratio de production capital/travail. L’augmentation du coût du travail sans affaissement du coût du capital impacte donc négativement la compétitivité-prix d’une industrie en renchérissant le prix de vente des biens et services produits et en favorisant la concurrence étrangère.
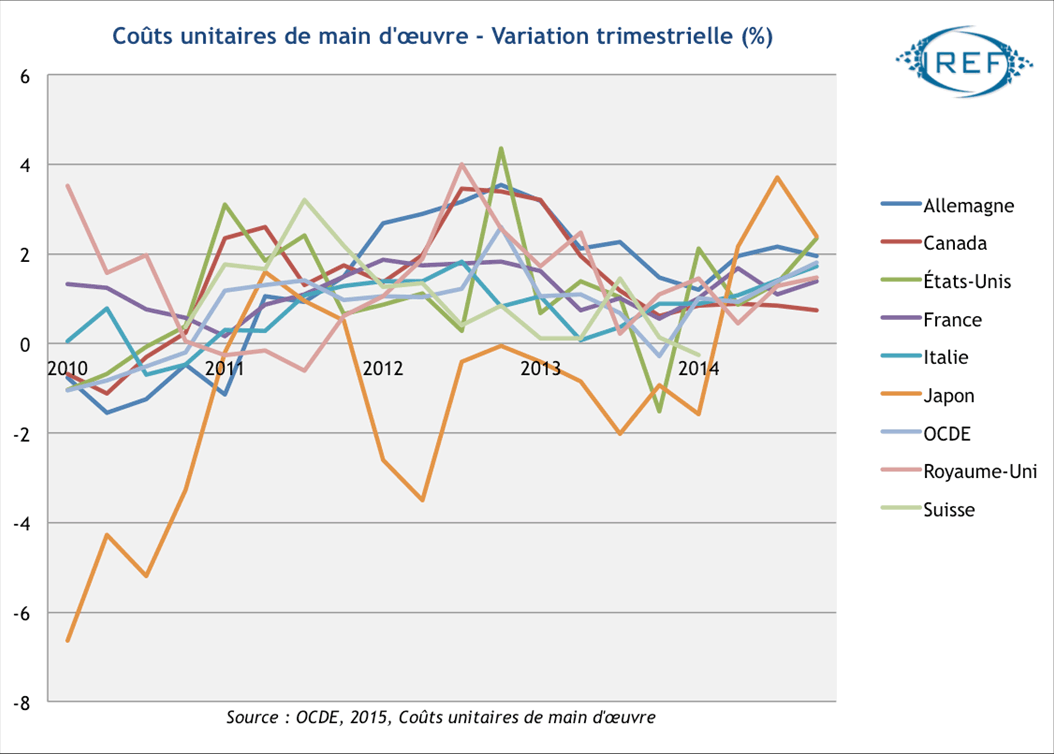
En outre, se pose la question du niveau des salaires. L’existence d’un salaire minimum horaire élevé en France contraint les employeurs à exclure du marché du travail les emplois les moins qualifiés et les moins productifs, ce qui conduit àun taux d’emploi considérablement plus faible que dans les pays où le salaire minimum horaire est faible voire inexistant. La théorie microéconomique a montré à de multiples reprises que le taux de chômage structurel, qui s’étend au-delà du simple chômage frictionnel résultant de l’adaptation de l’emploi aux chocs exogènes (changements technologiques, concurrence internationale, transformation de la structure productive, etc.), s’explique en grande partie par le coût relatif du travail par rapport au coût du capital. Un salaire minimum élevé couplé à une réglementation stricte du travail peut faire augmenter le coût marginal d’opportunité de l’embauche. Ainsi, les travailleurs les moins qualifiés, dont le niveau de diplôme ou de compétence est faible, et dont la contribution marginale à la valeur ajoutée ne serait pas suffisante pour couvrir le coût marginal du travail, sont exclus du marché du travail et condamnés à vivre des prestations sociales. Le salaire minimum renchérit donc également le coût social du chômage et le niveau de dépense publique. De plus, l’existence d’un salaire minimum élevé a tendance, par des effets de seuil, à normaliser le niveau de rémunération des travailleurs dont la contribution à la valeur ajoutée est la plus faible au sein de la société. Ce processus est nommé la smicardisation dans la société française et peut expliquer le maintien de faibles niveaux de rémunération au sein d’une part importante de la main d’œuvre. Enfin, le salaire minimum appauvrit le coût d’opportunité du capital et incite les entrepreneurs à privilégier l’investissement en capital fixe productif sur l’emploi. La question de l’inflation ou de la déflation salariale peut donc avoir des effets indésirables considérables si on laisse au gouvernement le soin d’arbitrer le ratio capital/travail dans la production.
Ce qui compte c’est la productivité globale des facteurs : la Suisse et le Canada sont les meilleurs
L’important est donc de se poser les bonnes questions. Quels sont les objectifs de la politique économique ? S’il s’agit de privilégier la productivité du travail sur la productivité du capital et d’accroître le revenu moyen des ménages, voire leur revenu net disponible, alors une stratégie d’expansion salariale peut être la planche de salut. Mais s’il s’agit de dynamiser la croissance, de maintenir un faible taux de chômage et un fort taux d’emploi, de réduire la dépendance sociale tout en rétablissant l’équilibre des finances publiques, il vaut mieux poursuivre la trajectoire de réduction des barrières à l’emploi, de la flexibilitédu travail, jusqu’à ce que toutes les capacités de production et la main d’œuvre disponible soient employées par le secteur productif. Ainsi les entreprises se tourneront alors vers l’investissement en machinerie, en biens d’équipement, et en technologie, afin d’accroître la productivité marginale du travail. Cette stratégie paraît plus payante sur le moyen et long terme, même si à court terme, les gouvernements peuvent retirer les bénéfices d’une politique orientée vers l’augmentation générale des salaires.
Comme le montrent les exemples du Japon, la Suisse ou le Canada, dont la productivité horaire des travailleurs est inférieure à celle du Royaume-Uni (à prix constants) et qui disposent tous de faibles taux de chômage et de salaires nominaux moyens élevés, l’important n’est pas la productivité unifactorielle du travail, mais bien la productivité globale des facteurs. En effet, ces trois pays ont tous les trois connus depuis 2005 une progression supérieure de la productivité totale des facteurs de production à celle de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni, bien que la progression la plus importante vienne de l’Allemagne (5 % entre 2005 et 2012). De plus, l’élévation de la productivité du travail ne vient généralement pas de l’accroissement du coût du travail, mais bien d’une politique éducative adaptée, de la formation professionnelle, de l’élévation des niveaux de compétence, de l’accroissement de la technologie de production, d’une meilleure division du travail ou encore de la simplification des tâches opérationnelles.
Si le Royaume-Uni veut réellement accroître sa productivité, c’est donc sur les exemples de la Suisse, du Canada, du Japon et des Etats-Unis qu’il devrait s’appuyer plutôt que sur l’exemple français, qui malgré une forte productivité du travail en comparaison des pays voisins, reste handicapé par un fort taux de chômage, une croissance atone et un fort niveau de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.
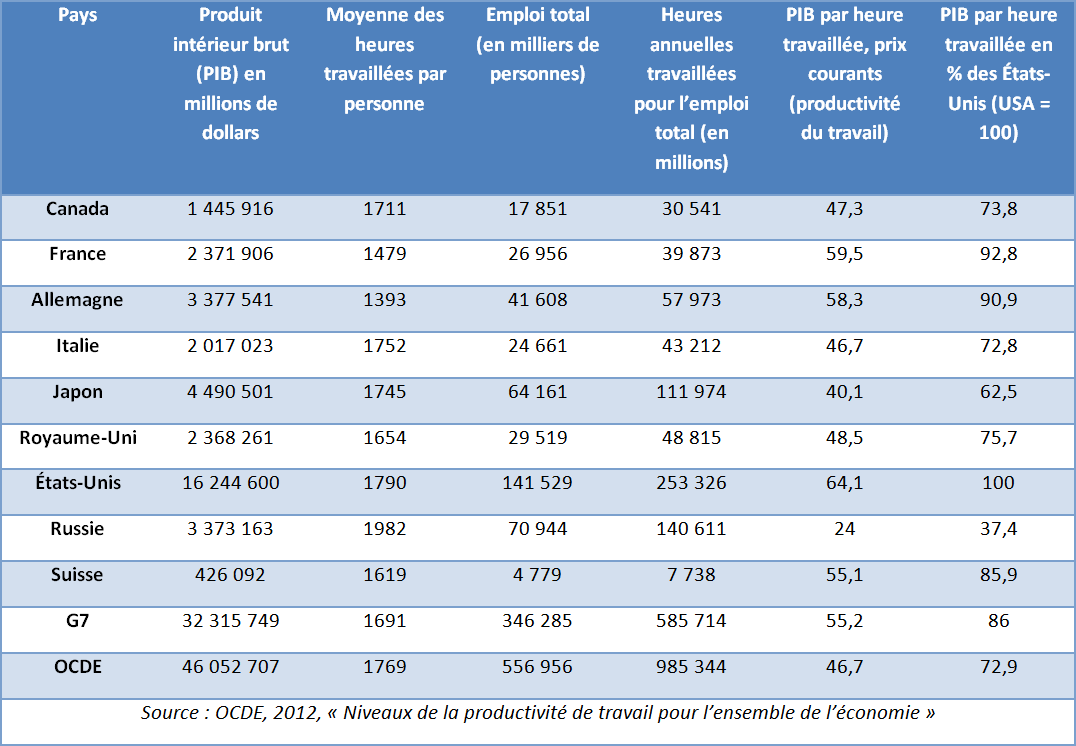
[1] Augustin Landier, David Thesmar, Le Grand méchant marché. Décryptage d’un fantasme français, Champs Actual, Flammarion, Paris, 2008